L’étude de la langue coopérative
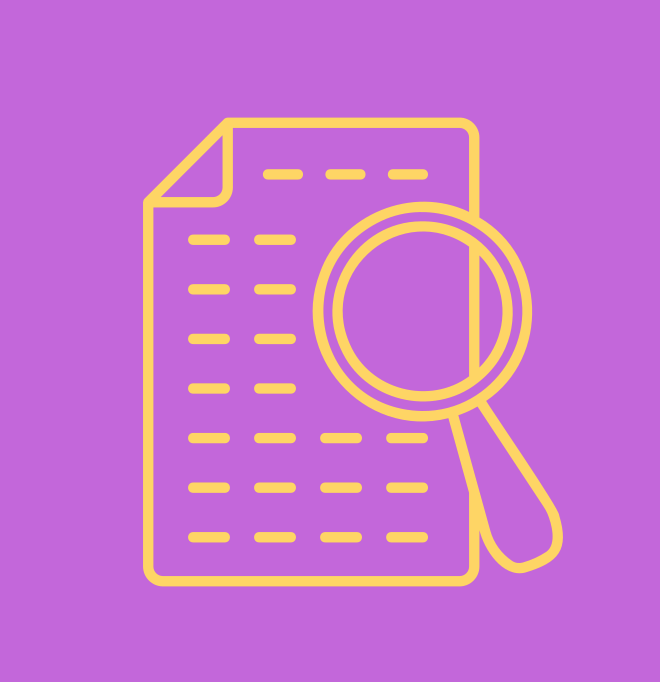
Au cours de deux ateliers, notre groupe a évoqué et comparé des manières coopératives de pratiquer l’étude de la langue (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire) dans nos classes, de la grande section au lycée.
Voici quelques idées à mettre en place, sachant que le point de départ est presque toujours le texte libre, mais qu’il y a autant de manières de faire que d’enseignant·es…
L’étude de la langue au cours de la semaine
En collège, une collègue propose à ses élèves : le lundi, amélioration d’un texte libre ; le mardi, grammaire coopérative ; le jeudi, dictée ; le vendredi, choix de textes et élection du texte pour la semaine suivante.
En lycée, une collègue propose : séance 1, les élèves proposent soit un texte écrit par eux soit un extrait choisi par eux d’une oeuvre au programme et on travaille sur le texte ; séance 2, la phrase de la semaine est fabriquée, améliorée, analysée grammaticalement et transformée collectivement (au bout de 4 phrases de la semaine, c’est la dictée) ; séance 3, texte libre en demi-groupe tous les 15 jours ; séance 4, échanges culturels, présentations de textes libres, travail individuel (exercices de grammaire, lecture, texte à étudier, leçon de vocabulaire, rédaction d’un paragraphe argumentatif…)
En CM1-CM2, un collègue propose deux séances d’étude de la langue par semaine, à partir du corpus GRECO (en lien avec les outils PIDAPI). Ces séances sont construites comme suit : (1) lecture d’une phrase à l’oral par l’enseignant (phrase issue du corpus Greco et non d’un texte d’enfant) ; (2) repérage des difficultés appelées « alertes » (accords, homophones, etc.) ; (3) dictée de la phrase avec les outils à disposition (lexique, dictionnaire, tableaux de conjugaison) ; (4) phase coopérative pour se mettre d’accord par groupe sur l’orthographe adéquate ; (5) analyse grammaticale de la phrase ; (6) invention d’une autre phrase avec des éléments de la phrase de départ (contraintes d’écriture).
Quoi qu’il en soit, on note que la ritualisation permet aux élèves de s’approprier la logique de l’exercice, de s’en emparer, et parfois de demander des évolutions en Conseil de coopération.
La correction orthographique des textes libres
Nous avons tous·tes de pratiques différentes sur ce point : laisser l’élève corriger à l’aide d’un code de correction ou recopier entièrement le texte correctement orthographié (à la main ou à l’ordinateur) ; modifier uniquement l’orthographe ou aller plus loin dans sa correction (modifications de vocabulaire, de style) ; laisser ou pas à l’élève la possibilité parfois de ne pas être corrigé du tout… Autant de manières de faire que d’enseignant·es, et surtout que d’élèves car on adapte au niveau de chaque enfant ce qu’on lui demande. On peut par exemple choisir de presque tout corriger mais en lui laissant quelques erreurs à corriger à l’aide d’un code de correction (conjugaison, accords, ponctuation, répétition…).
On constate tout de même que généralement, la relecture immédiate n’apporte pas d’améliorations. Il est bon de différer la relecture de son propre texte, si besoin avec une grille de relecture (ex: j’ai pensé à mettre les majuscules au début des phrases ; quand je dis « il » ou « elle » on sait de qui on parle ; j’ai mis des s au noms pluriels…), qui permet de corriger déjà le brouillon remis à l’enseignant·e. Parfois en se relisant le lendemain l’élève (surtout petit·e) ne comprend plus ce qu’iel avait écrit ou n’arrive pas à se relire ! Cette prise de conscience est une étape importante de l’apprentissage.
L’entraînement à l’orthographe
Que ce soit pour l’orthographe lexicale ou grammaticale, les élèves s’entraînent chaque semaine (dans certaines classes, chaque jour) à écrire : des listes de mots courants (de type échelle Dubois-Buyse), des listes de mots invariables ainsi qu’une liste personnalisée (appelée Orthofiche par notre défunt collègue Michel Barrios).
Cette liste est issue des mots mal orthographiés dans les textes libres. C’est donc la liste d’un élève en particulier, qui n’aura pas les mêmes que son voisin ou sa voisine. Plus l’élève écrit, plus sa liste orthographique personnelle sera longue, en général. En face de chaque mot on trouve plusieurs petits cercles destinés, lors de l’entraînement, à indiquer si l’élève a correctement écrit (on colorie le cercle en vert) ou s’il s’est trompé (on colorie en rouge).
Il existe plusieurs manières de faire réviser cette liste de mots personnalisés. L’élève peut s’entraîner seul·e. La consigne est alors : je lis les yeux ouverts, puis les yeux fermés (je vois les mots) ou j’épelle le mot dans ma tête, puis j’écris les yeux ouverts sur l’ardoise ou le cahier de brouillon, et enfin j’écris les yeux fermés. L’élève peut aussi s’entraîner à la maison à l’aide d’un parent ou d’une grande soeur / grand frère. Et enfin, cela peut se faire en classe par le biais d’une « dictée coopérative » c’est-à-dire d’une dictée par binôme : l’élève A prend la liste de l’élève B et lui dicte ses mots. A chaque mot, il colorie en vert ou en rouge un des petits cercles. L’élève B fait de même avec les mots de l’élève A. Chaque élève est donc tour à tour évaluateur et évalué.
La grammaire coopérative
Au Congrès 2025 de l’ICEM, une collègue a transmis cette technique, que nous nous sommes appropriée. Il s’agit d’analyser grammaticalement puis de transformer une phrase issue du texte libre choisi par la classe. L’activité se fait par groupes (îlots, équipes, groupes homogènes pour certains, hétérogènes pour d’autres). Dans chaque équipe, un·e élève est animateur·trice. Il ou elle a la correction sous les yeux mais ne la dévoile que petit à petit, grâce à un cache (papier A4 plastifié ou pochette).
La phrase est écrite par l’adulte au tableau et les élèves la recopient dans un premier temps sur des lignes en haut de sa feuille.
Dans un second temps, les élèves doivent analyser grammaticalement la phrase de deux façons : au-dessus de la phrase, les natures de mots doivent être indiquées à l’aide des symboles Montessori (triangles pour le groupe nominal, rond rouge pour le verbe, etc) ; et au-dessous de la phrase, les fonctions des groupes de mots doivent être données (sujet, C.O.D, compléments circonstanciels…).
L’élève animateur peut se déplacer, demander à chacun·e ce qu’iel a trouvé, demander de justifier, voir qui n’est pas d’accord, etc. En dernier lieu iel dévoile la correction et aide à rectifier le cas échéant.
Dans un troisième temps, la phrase subit une série de transformations : mets la phrase au présent en commençant la phrase par « Maintenant » ; mets la phrase au futur en commençant par « Demain » ; ajoute des adjectifs épithètes à tous les noms communs ; ajoute des adverbes à tous les verbes conjugués ; etc. Ces consignes peuvent varier au cours de l’année. En dessous de chaque transformation, une place est laissée pour la correction, que l’animateur.trice vérifiera.
La dictée coopérative
Elle aussi issue d’un texte libre choisi par la classe à l’issue du choix de textes, la dictée coopérative consiste à se mettre d’accord entre élèves par binômes ou par équipes sur l’orthographe. Soit on la fait au crayon et on gomme les erreurs, soit on la fait au stylo et on surligne les mots sur lesquels on n’est pas d’accord dans l’équipe ou le binôme. On a droit aux outils de la classe (dictionnaires, affichages, leçons, tableaux de conjugaison…). Une fois que toute la classe est d’accord, on prend la correction.
Un rituel de conjugaison
Une personne / un verbe. On choisit une personne (par exemple la deuxième personne du singulier) et un verbe. Il s’agit de conjuguer à différents temps, le plus possible. Le nombre de temps demandés peut aussi varier en fonction des ceintures de compétences (par exemple le subjonctif ou le passé simple peuvent être demandés à des hautes ceintures).
La phrase de la semaine
Au lycée, une collègue procède ainsi : on fabrique une phrase ensemble, que l’enseignante écrit au tableau telle qu’elle est dite, sans ponctuation. Les élèves améliorent peu à peu la phrase, cherchent une formulation plus claire, font des remarques sur la valeur des temps, la place des adverbes, les registres de langue, le vocabulaire. Puis la phrase est analysée grammaticalement (natures et fonctions), et enfin transformée (les transformations sont proposées par l’enseignante, puis peu à peu par les élèves eux-mêmes).
En CE2-CM1, une enseignante propose la méthode DRAS de Maryse Brumont : Déplacer / Remplacer / Ajouter / Supprimer. Déplacer permet de repérer les compléments circonstanciels ; Remplacer permet de trouver des synonymes (y compris pour enlever les mots « passe-partout » comme « il y a » , le verbe « faire »… ) et des pronoms ; Ajouter permet d’introduire des adjectifs, des adverbes, des propositions relatives…
La phrase de la semaine s’accompagne de copie et/ou de dictée…
